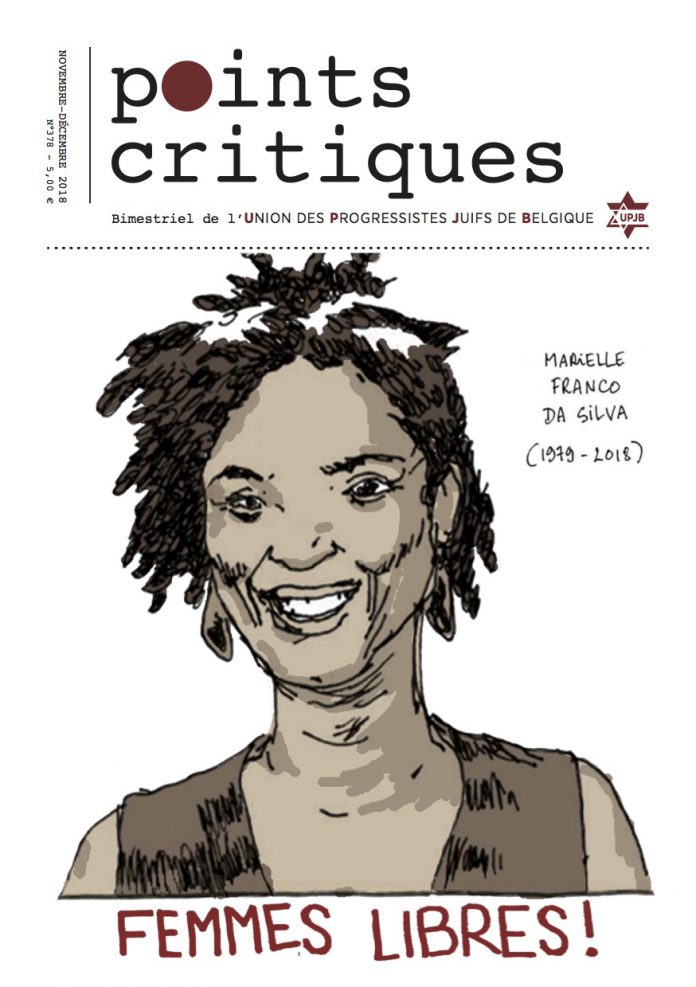À Bruxelles comme ailleurs, 15% des réfugiés sont des femmes, d’Afrique subsaharienne pour la plupart. Mais qu’affrontent-elles ? Comment construire un chemin d’émancipation malgré les discriminations croisées, la violence omniprésente sous toutes ses formes ?
M, 17 ans, et son amoureux, I, 20 ans, ados dans la tourmente de l’exil. Ils ont quitté l’Érythrée il y a trois ans, avec l’accord de leurs parents. Il parle l’anglais, plutôt bien. Elle ne dit rien, mais entre eux deux, ça tchatche solidement. Visiblement, elle gère leur couple en itinérance. Pas comme M, cette Ethiopienne tout juste arrivée d’Allemagne. Elle a passé une nuit chez moi avec un homme d’une trentaine d’années, au Parc Maximilien depuis 14 mois… un mufle : il a dévoré toutes les ailes de poulet, rien pour elle. Elle n’a rien dit. Le lendemain, je lui ai remis 5 euros pour le tram, qu’elle a aussitôt tendus au mufle. J’ai appris par la suite qu’il y a beaucoup d’unions de circonstance où une femme s’en remet à la « protection » d’un homme en échange d’un service sexuel. Quitte à se faire débarquer du camion vers Calais s’il n’y a pas assez de place. La migration renforce sans doute les sujétions traditionnelles.
De protection, oui, elles en ont besoin. Oui, elles sont beaucoup plus vulnérables, mais pas moins déterminées. Moins scolarisées, elles n’ont pas la même aisance en anglais, ne parlons pas du français. J. est venue chez moi. Elle dit avoir 21 ans. Devant ma cuisinière, « je n’ai jamais vu ça dans mon village des montagnes », J. a préparé un délicieux ragoût avec trois fois rien. Elle ne lit et n’écrit que l’amharique. L’anglais et l’arabe, elle les a appris sur la route, elle les parle, mais ne sait pas lire ces alphabets. Elle a été servante au Liban, enfermée et bossant jour et nuit pour 150 euros par mois dans une grande famille. L’image de La Noire, dans le film du sénégalais Sembene Ousmane m’est revenue. Une histoire de séquestration en France qui finit mal. J. raconte un peu : après le Liban, elle est passée par Hambourg quelques mois, mais elle se sentait étouffer là-bas. Elle a pris la route pour Bruxelles, parce qu’elle veut passer en Angleterre. Grâce à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, elle n’a « dormi » que trois nuits au Parc Maximilien, réveillée par un homme qui agrippait la tirette de sa veste, mais trop assoupie pour voir qu’on lui volait ses chaussures. Comme les autres, elle est restée à l’écart des mêlées d’hommes affamés se ruant sur les barquettes et les sacs de sandwiches. Les violences à caractère sexuel, non, elle ne les craint pas : « Je ne veux pas d’homme maintenant, et je cours vite ». Elle me montre une photo d’elle en puissante marathonienne. Femme à tout faire surexploitée ou athlète, quel avenir notre société lui laissera-t-elle s’inventer ? Elle éclate de beauté et de santé, s’esclaffe dès qu’elle raconte un truc difficile. Mais elle est déterminée, elle veut « try chance ». Un passeur lui a demandé 800 euros qu’elle n’a pas, à payer en deux fois, avant et après, si la tentative réussit. Une connaissance, active dans Vluchtelingenwerk, (l’équivalent flamand du Ciré), lui explique en amharique l’existence de réseaux de passeurs impliqués dans le proxénétisme. J. écoute, mais peu importe, elle veut aller en « England ». Comment lira-t- elle un avis d’expulsion en français ou en néerlandais si elle se fait chopper ? Comment assumera-t-elle le racisme et les «Tu es venue ici pour faire la pute ! » ll y a vingt ans, Semira Adamu et son amie Fatimata Mohammed, amies et demandeuses d’asile l’ont entendue souvent, cette insulte. Semira est morte tuée par le coussin des gendarmes, Fatimata a risqué sa vie dans une tentative d’expulsion très violente. Elle a survécu, elle vit en Belgique où ses trois enfants sont nés. Mais n’a pas pu pardonner.
ESPACE FEMMES
Au Hub humanitaire, à la gare du Nord, la salle d’accueil est remplie à craquer. Il y a en moyenne 300 visiteurs chaque jour. L’équipe court, les talkie-walkie crachotent. On y vient pour une consultation médicale ou sociale, pour des vêtements, pour recharger sa batterie, appeler un parent retrouvé grâce au réseau de la Croix-Rouge. J’y rencontre Luisa Ben Abdelhafidh, 29 ans. Avec Aurélie Van Rompaey elle coordonne les activités de Médecins du Monde et a installé l’Espace femmes avec Céline Glory, responsable de la santé reproductive et sexuelle chez Médecins du Monde : « au début les réfugiées ne venaient pas ici, ou hélaient les doctoresses au hasard. Pourtant leur situation est la pire des pires ». C’est éprouvant pour elle aussi, « cette marée de détresse et de problèmes » mais elle tient le coup. Il a fallu inventer, installer la confiance, avec les maraudes au Parc, la distribution de kits d’hygiène en association avec BruZelle : « Pour écarter les hommes et trouver un moment de parole plus intime, il suffit d’un mot magique periods (règles), ça fait fuir les hommes ! » (Rires). Au hub humanitaire, cinq sages- femmes sont venues s’ajouter aux vingt docteurs et autant d’infirmier.e.s, tous bénévoles. En Afrique, elles font les accouchements et dirigent les postes de santé villageois, elles ont le savoir-faire de base et l’aura qu’il faut. Les exilées ont les mêmes maladies et accidents que les hommes, leurs problèmes gynécologiques et tout ce qui n’est pas strictement médical : les violences sexuelles, la prostitution. « Souvent elles ont quitté leur pays très jeunes, sans éducation sexuelle, certaines ne savent pas si elles ont été excisées ou non, ni quel type de mutilation génitale elles ont subi ». Luisa me montre les panneaux didactiques destinés à aider les femmes. Au Hub les femmes trouveront aussi un test rapide de dépistage des MST les plus dangereuses, des pré- servatifs et une contraception adaptée. De l’écoute. Elles parlent des violences si on les interroge.
« LE VIOL, UN PRIX À PAYER »
Parfois c’est un viol ou un mariage forcé qui a provoqué la fuite. Sur la route, elles savent que ça peut arriver encore, par les geôliers en Lybie ou par les compagnons d’exil : « Pour beaucoup de réfugiées, c’est le prix à payer pour atteindre leur destination. Elles sont vulnérables, mais lucides et pragmatiques. Elles n’ont pas envie de consultation psy, cela n’appartient pas à leur culture. Elles viennent en consultation le plus souvent pour un retard de règles ». Si une IVG s’impose, les réfugiées seront envoyées vers un planning familial. « Il faut aller vite, explique Luisa, parce qu’il s’agit typiquement d’un public pressé. » Le délai actuel de la loi, 12 semaines de grossesse maximum, les quatre jours de réflexion sont trop contraignants dans cette situation. Dans certains CPAS, il faut souvent jusqu’à 3 semaines pour obtenir l’Aide Médicale Urgente. Et où se reposer après une IVG ? Le Samusocial ne peut prendre que les adultes, d’autres structures exigent des papiers, et les femmes préfèrent ne pas en parler à leurs familles d’un temps. Luisa voudrait la gratuité automatique de l’IVG pour les réfugiées, une vraie dépénalisation de l’IVG et surtout un véritable Centre d’accueil et d’orientation pour les réfugiées. « Vous imaginez, mettre un enfant au monde dans la pire des situations possibles ? Heureusement on a quand même quelques jolies histoires de couples ». Trois ou quatre bébés sont nés dans de bonnes conditions depuis le début de l’année. Et une femme sur deux revient au Hub. Elles ne sont plus tout à fait seules avec leur corps, leur histoire, leurs tabous, leurs désirs, et partout la convoitise.