Au 255e jour du confinement, les singes sont apparus. C’étaient de petits gibbons roux, les yeux cerclés de noir, un air placide et narquois sur le museau. Personne ne pouvait dire d’où ils étaient venus et toutes sortes de théories circulaient sur leur compte : ils s’étaient échappés de Pari Daiza et avaient pris le train jusque Bruxelles ; détenus dans un zoo privé du côté de Uccle, ils avaient mis leur gardien en pièces avant de s’évader dans la ville ; ils venaient de Chine par avion cargo ; c’étaient des infiltrés de la CIA… Dans la rue, les gens vêtus de combinaisons faites maison, chacun la sienne comme pour un mardi gras, les évitaient soigneusement. D’ailleurs on ne croisait pratiquement personne d’autre que des agents de police à vélo, des journalistes qui cherchaient des passants à interroger, des ambulanciers qui embarquaient les malades et les morts, et les singes bien sûr. La presse n’en parlait jamais, si bien que, étrangement, chacun en venait à douter de leur existence. Parfois, lors du journal télévisé du soir, lors d’un micro-trottoir, on pouvait apercevoir une de ces créatures à l’arrière-plan, derrière un passant déguisé, emmitouflé, qui tentait laborieusement de répondre aux questions d’un journaliste à travers son masque de laine, de polyester ou de lin (selon les recommandations officielles). Et comme les journalistes eux-mêmes portaient des combinaisons et des masques, les échanges étaient pénibles à comprendre et nous ne prêtions plus attention aux gibbons qui passaient presque inaperçus à l’arrière-plan.
Dans les parcs, alors que nous nous nous adonnions à l’exercice hebdomadaire obligatoire, seuls les singes et les policiers pouvaient rester assis sur les bancs. Ces derniers chronométraient nos allées et venues. À l’époque, nous ne pouvions nous déplacer à une vitesse inférieure à 2,6 km/h et certains d’entre nous n’y parvenaient pas. Les plus lents étaient renvoyés chez eux avec une amende, et les singes, bien installés, semblaient se moquer, ouvrant grand la gueule, dévoilant leurs dents pointues et poussant un cri aigu.
Quand le mardi nous faisions la file avec nos tickets de rationnement, les singes dépassaient systématiquement, ils se tenaient en groupe, sur leurs deux pattes arrière, juste à l’entrée du magasin, et quand la porte s’ouvrait enfin, ils se précipitaient dans le désordre pour se saisir des fruits et des légumes frais.
En réalité, nous n’en parlions que rarement entre nous. Nous ne parlions d’ailleurs que très rarement, et cette question des singes était comme taboue. Notre vie s’était tant dégradée depuis leur arrivée et peu d’entre nous trouvaient le courage d’évoquer cette affaire quand, par chance, il nous arrivait de pouvoir contacter un proche via internet ou les lignes fixes. Tout était détraqué.
Les singes trainaient en bande. Ils descendaient les avenues avec une sorte d’arrogance, leurs fruits à la patte, jetant parfois une banane vers un passant comme s’il lui faisait l’aumône. Nous n’avions plus, à l’époque, beaucoup d’amour propre et aucun d’entre nous n’aurait hésité à se mettre à quatre pattes pour attraper un fruit frais. Même les journalistes. Et même les policiers. D’ailleurs, qui aurait pu nous reconnaître, sous nos couches protectrices et nos masques officiels ? Nous n’étions plus vraiment nous-mêmes.
Au bout de trois longs mois de sidération, privés de liens, d’identité et de nourriture fraîche, la colère commença à gronder. C’étaient des petites manifestations spontanées. Certains descendaient dans la rue avec des pancartes : « A bas les singes ! », « Libérez-nous des singes ! » ou, plus martial, « A mort les gibbons ! ». Ils les brandissaient tous en même temps, anonymement sous leurs carapaces de tissus, tout en respectant les deux mètres réglementaires de distanciation sociale. Ces cortèges de manifestants silencieux évoluaient dans la ville à la vitesse constante de 2,6 km/h, et quand les marcheurs croisaient une bande de primates, ils agitaient leur pancarte dans leur direction, comme si les singes avaient été capables de lire.
Au 365e jour de confinement, les singes disparurent. Pas progressivement, d’avenue en avenue, de parc en parc, mais brusquement, comme s’ils n’avaient jamais été là. Il nous fallut cependant un certain temps pour comprendre qu’ils ne reviendraient pas. Au début, les citoyens, toujours bien camouflés sous leurs textiles, déambulèrent un peu dans les rues et, contrairement à tous les règlements en vigueur, ils ralentirent, s’arrêtèrent même parfois pour vérifier que les primates n’y étaient plus. Les malchanceux glissaient sur des bananes trop mûres, mais tout cela se faisait dans une grande joie. Une joie muette, qui respectait les distances de sécurité. A la distribution de nourriture du mardi, on entendait comme un bourdonnement satisfait. Chacun faisait la file avec patience et repartait avec son lot de légumes et de fruits, le serrant fort sur sa poitrine comme un cadeau de Noël attendu tout au long de l’année. Lors de nos séances d’exercices dans le parc, presque tous parvenaient à tenir la cadence, même les quelques anciens qui avaient survécu. Et les policiers devenus indulgents ne distribuaient plus d’amendes à la moindre défaillance.
Petit à petit, nous avons retrouvé la capacité de parler. Les problèmes techniques étaient moins fréquents et nos langues se déliaient peu à peu. Quelle histoire incroyable, impossible à croire. Nous même, nous en doutions. Nous en avions toujours douté. Les singes avaient-ils vraiment envahi Bruxelles, paralysée par le confinement ? Avaient-ils volé nos fruits ? Nous avaient-ils jeté des bananes que nous nous étions abaissés à ramasser ? Quel soulagement indicible nous apportait leur mystérieuse disparition. Quelle joie de retrouver notre monde tel que nous le connaissions, ordonné, structuré, sans fioritures et sans imprévus. Bien sûr, les gens tombaient malades et ils continuaient à mourir. Mais nous n’avions jamais été aussi heureux.


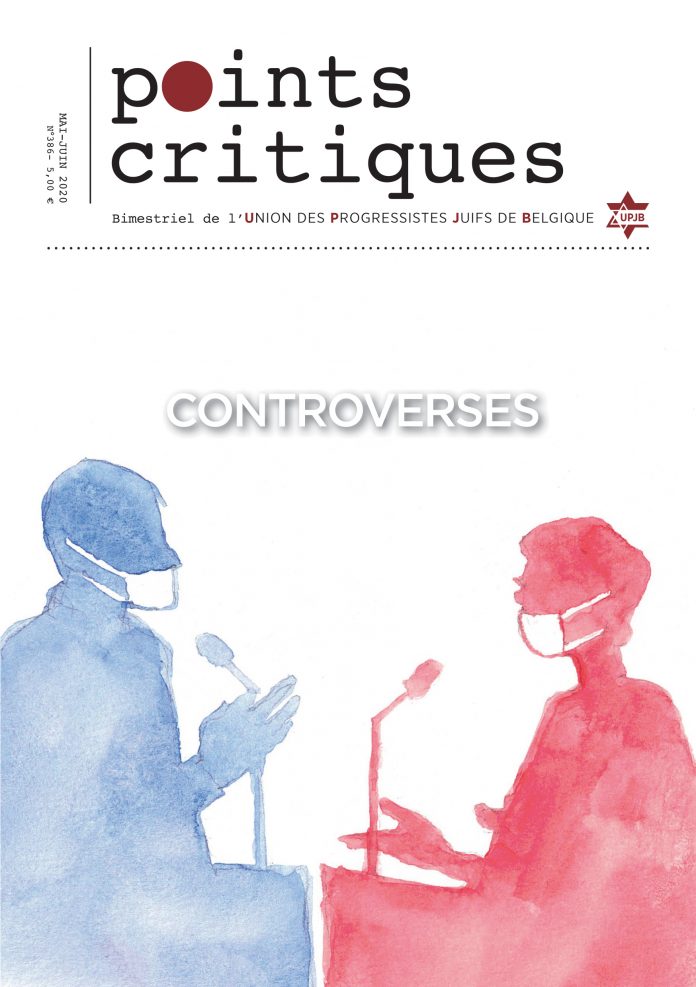

![[opinion] Vers la régularisation collective d’un demi-million de sans-papiers en Espagne](https://upjb.be/wp-content/uploads/2026/02/By-Adam-Jones-from-Kelowna-BC-Canada-Pro-Immigrant-Demonstration-Placa-Jaume-Barcelona-Spain-CC-BY-SA-2.0-httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid64195245-1-218x150.jpg)

