Je suis un pur produit de l’émigration juive des 19e et 20e siècles ou de l’antisémitisme qui a poussé mes grands-parents (ou leurs parents), sans s’être concertés le moins du monde, à se pencher sur une mappemonde et à poser le doigt sur un petit coin déjà connu dans les récits de voyageurs en transit. C’était Anvers ; la métropole, et pas la capitale d’un pays qui, depuis 1830, avait la réputation d’être ouvert, tolérant et libéral. À bon droit. Je n’ai jamais connu ni même visité l’une des villes dont ils provenaient et qui leur étaient familières : Wielicka, Tarnopol, Cernowitz ou Vorno. Cette dernière, un hameau sans doute, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur de transcription sur un document administratif, je ne suis même pas parvenu à la localiser ; quelque part aux environs de Vilnius.
À Anvers, où il y avait déjà des Juifs, il était possible de travailler, et donc de s’intégrer petit-à-petit ; mes grands-parents maternels s’y sont rencontrés, les autres grands-parents étaient déjà mariés quand ils y sont arrivés plus tard avec leur fils adulte ; mon père y a connu ma mère (par une vieille tradition de marieurs, on ne sait jamais…)
Avec ses parents, ma mère, déjà veuve à 27 ans, est venue s’établir à Bruxelles en 1940 ; on croyait la capitale plus sûre que la ville portuaire, jugement fondé en partie, mais en partie seulement, comme allaient le prouver les événements. Mes souvenirs de Bruxelles à cette époque sont assez furtifs et se bousculent entre l’exode de la mi-40 jusqu’à Bordeaux et l’expulsion des enfants juifs des écoles à la mi-42. Enfant caché en internat, brièvement arrêté et emprisonné à la Citadelle de Liège, encore libéré comme d’autres Juifs belges (ce que j’étais de naissance au prix d’une nationalité chèrement acquise par les générations précédentes), je finis la guerre chez un couple d’instituteurs du Brabant wallon. Devenu orphelin au milieu d’une famille décimée, il me fallut passer encore trois ans en internat dans le Condroz. J’étais devenu plus campagnard que citadin. De mes sentiments très partagés et complexes sur ce qui m’était advenu durant cet exil forcé, je garde l’impression de beaucoup de refoulements pour survivre et d’une chance exceptionnelle qui m’avait permis de traverser cette période dramatique sans perdre une seule année de ma scolarité. J’ai mis longtemps à reconstituer tant bien que mal les faits qui s’étaient produits durant mon absence et surtout à comprendre leurs antécédents historiques. Je n’y parviendrai jamais, tant cet arrière-plan de longue durée véhicule d’enchainements hasardeux et souvent irrationnels.
Ce n’est donc qu’à l’âge de quinze ans que je devins un véritable bruxellois ; sans doute pour rattraper le temps perdu. J’achevai mes humanités (quel beau nom !) à l’Athénée Robert Catteau, fleuron pédagogique de la Ville. Sa fréquentation et son utilisation m’apprirent spontanément qu’il existe dans toute cité une ville basse et une ville haute. L’école avait été conçue pour l’éducation des enfants de la ville basse avec entrée monumentale sur la rue des Minimes. Mais depuis sa conception, les libéraux qui gouvernaient traditionnellement la capitale (la commune centrale de Bruxelles-Ville) avaient gagné la ville haute, suivant en cela leur clientèle de médecins, d’avocats, etc., ou les nombreux justiciables du nouveau Palais de Justice. Leurs enfants entrèrent donc par la loge du concierge, côté ville haute, et l’entrée basse demeura définitivement close. Bien que le cours d’histoire fût l’un des seuls à être mal donné (avec le lamentable manuel de Van Kalken), j’appris aussi comment les libéraux, de progressistes étaient devenus conservateurs. Et selon quelle loi les gens de gauche finissent généralement à droite. C’est durant ces trois dernières années du secondaire que naquirent quelques-unes de mes plus durables amitiés.
Ce fut grâce au mariage d’une jeune tante qui m’avait pris en charge que je m’enracinai ainsi en ville et devins pour toujours un indéfectible citadin. Les parents de son mari, nés dans le centre-ville, m’en firent goûter le charme et furent pour moi de précieux grands-parents de substitution. C’est chez eux que je bloquais mes examens et que je passais une partie de mes fins de semaine.
J’entrai en 1951 à l’Abbaye de la Cambre – pas dans les ordres mais en architecture – dans une école des arts et de l’architecture offrant une liberté peu commune. J’appréciais particulièrement que ces disciplines y côtoient l’urbanisme. J’y voyais le moyen d’aborder la ville autrement que par sa fréquentation quotidienne. Une enquête m’amena à étudier la commune d’Evere, pionnière de la culture du « chicon » si typiquement belge. Juif parfaitement assimilé et fier de l’être, on aurait pu m’entendre dire : « nous » avons inventé ce légume que les Français appellent endive et dégustent autrement. L’assimilation de tous les citoyens est l’une des grandes conquêtes de l’esprit révolutionnaire ; assimilation : « Action de présenter comme semblable » ; Assimiler : « convertir en semblable. La civilisation tend à assimiler différents peuples » (Littré). J’ai mis longtemps à découvrir comment d’étroits nationalistes avaient transformé le beau slogan de 1789 en insulte : assimilateur, assimilationniste (quelle horreur !), alors que tous les Goïm (les gentils !) sont de véritables assimilés au judaïsme. Aïe, je m’emballe. Vite, mon dico : du latin ecclésiastique gentiles (« les barbares, les païens »), calque du grec ta ethnè, pluriel de ethnos qui dans la Bible, employé exclusivement au pluriel, prend le sens spécifique et collectif de « non juifs » par rapport au « peuple juif », le peuple élu de Dieu (Wiktionnaire en ligne, ah le progrès !) Beaucoup plus tard j’ai compris pourquoi le philosophe juif allemand Constantin Brunner avait écrit : Discours des Juifs : Nous voulons le reprendre, et c’est du Christ qu’il parlait. Quand un peuple errant dépose son bâton de marche – vous savez : celui que l’on tient à la main pour célébrer la Pâque dans le désert –, il est parfaitement bon et naturel qu’il devienne semblable à tous ceux qui l’entourent.
Mais revenons à mon Bruxelles. Avec de frais diplômes en poche et après avoir achevé un service militaire (ça existait encore), que faire (d’intéressant de préférence) pour nourrir la famille qui commençait à prendre forme ? Nous, enfants de la guerre, étions pressés d’enfanter à nouveau. J’avais rencontré à La Cambre mes futurs associés – nous allions restés unis pendant quarante années, avis aux candidats à ce pari osé.
Assez libres d’esprit pour accepter nos différences et nos inclinations : la pratique de l’architecture ou de l’urbanisme, l’enseignement, l’écriture ; à la rigueur des engagements sociaux ou politiques qui ne devaient pas forcément converger.
Les ressorts du développement urbain m’intéressaient particulièrement. En 1973, je consacrai un court essai à la spéculation foncière qui ravageait nos villes, deux ans plus tard au résumé d’un séminaire introduit à La Cambre (où j’étais devenu chargé de cours) : Architecture et société, et trois ans après j écrivis un petit livre que je vois encore entre les mains d’étudiants actuels : Le tournant de l’urbanisme bruxellois, 1958-78 . Je le dédiai « à la mémoire de ma mère, Félicie Aron-Lewin, morte à Auschwitz à l’âge de trente ans ».
J’y relatais les vingt ans de transformations accélérées dont l’Expo ‘58 avait été l’occasion et souvent le prétexte. Le tout à l’automobile s’amorçait, la production d’immeubles de bureaux, bref la devenue proverbiale « bruxellisation ».
Sous l’impulsion de l’État central, la capitale avait cédé dès le siècle précédent à un remaniement d’autant plus dramatique qu’il allait être interrompu par deux guerres mondiales : les travaux de la Jonction Nord-Midi. De 1903 à 1958, cette blessure à flanc de colline allait saigner la ville. Contrairement à Paris qui reliait ses gares par un métro urbain, Bruxelles s’ouvrait littéralement à une mobilité nationale, tout en subissant de plus en plus les conséquences désastreuses d’une navette quotidienne accrue vers une capitale administrativement morcelée et maintenue dans un carcan. À cette pénétration des voies ferrées vint s’ajouter une pénétration automobile souterraine jusqu’au cœur de la ville : la Grand-Place et quelques rues avoisinantes ironiquement nommées « L’Îlot sucré » (il était dit « sacré ») étaient sur le point d’être prises dans un collet autoroutier. On connaît la réaction que cela suscita.
L’occasion nous fut donnée, à mes associés et moi, de vivre de près une expérience unique dans l’histoire politique du pays. Cinq grandes agglomérations devaient y être crées ; seule celle de Bruxelles vit le jour et suscita tant de problèmes et de bouleversements qu’elle demeura unique et éphémère. Jamais on n’avait vu, et sans doute ne reverra-t-on jamais plus, un organe politique reconduit durant treize années sans nouvelle élection. La Région était en gestation dans une Belgique régionale et l’on sait combien cette conception s’oppose à l’option communautaire du Nord du pays. Un ministre des Affaires bruxelloises entra dans le gouvernement central. Bruxelles poursuivait ainsi son destin de capitale amorcé dès le 15e siècle sous les ducs de Bourgogne. Difficile à comprendre et surtout à vivre pour les habitants des différents quartiers souvent dépossédés de leur pouvoir de citoyen, tirés à hue et à dia, et parfois tentés par une opposition systématique à une politique désordonnée et contradictoire.
Je pus voir de près tous les décideurs mais, plus intéressant encore, j’acquis une connaissance approfondie du fonctionnement de cette agglomération et je côtoyai ses habitants de tous quartiers et de toutes conditions sociales. Bruxelles s’était mise en mouvement, mais trop lentement et, vu les questions actuelles, ce n’est pas sans tristesse que je relis mon petit livre vieux de près de quarante ans : « L’efficacité du transport en commun à Bruxelles se joue aussi en surface [après mise en route du métro ou pré-métro]. Les propositions de la STIB en vue d’assurer aux trams et bus circulant en voirie une véritable priorité n’ont jamais été prises sérieusement en compte. Il n’est pas trop tard pour le faire . » Ce fut un combat permanent. Un tiers des articles que j’écrivis dans les Cahiers marxistes entre 1969 et les années 1990 est consacré à cette évolution.
Trois autres concernent la condition juive, à laquelle, actualité oblige, j’allais consacrer plus de temps après la fin de mon enseignement et de ma pratique de l’architecture et de l’urbanisme en 1998. Mais ceci est une autre histoire. À Bruxelles, toujours et pour toujours.


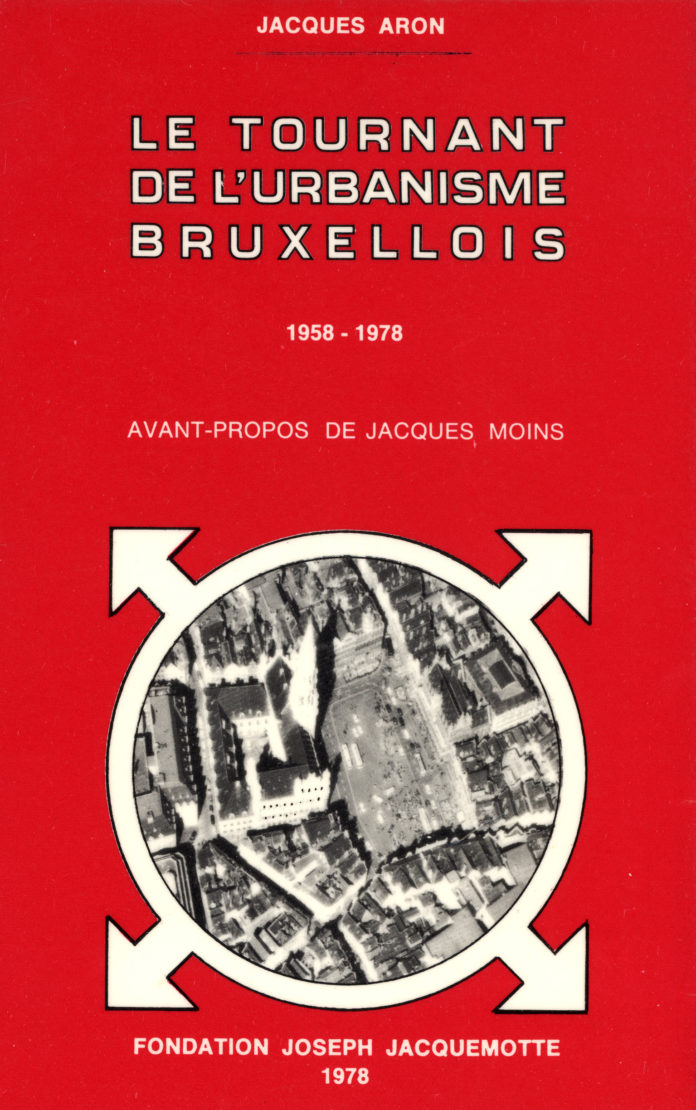
![[Archives du POC] 100eme anniversaire du Bund](https://upjb.be/wp-content/uploads/2025/12/UPJB_001_page-0001-218x150.jpg)
![[Belgium4Palestine] Soutenez l’organisation des manifestations nationales](https://upjb.be/wp-content/uploads/2025/12/Donate-2_page-0001-218x150.jpg)
![[Communiqué] Un tag antisémite à quelques rues de chez nous](https://upjb.be/wp-content/uploads/2024/04/12-e1713864333392-218x150.png)
